Sylvain Maestraggi Les temps du paysage

Ici et ailleurs, Sylvain Maestraggi explore et donne à voir la ville et le territoire, en faisant dialoguer images et textes, pour comprendre leur évolution et faire émerger de nouveaux récits.
Propos recueillis par Christophe Asso
Pour commencer, j’aimerais que vous me disiez à quel moment la photographie est apparue dans votre parcours.
Mon père a toujours fait beaucoup de photos. Quand j’étais petit, il faisait ses tirages dans la salle de bain. On faisait des soirées diapo. Mon père adore la montagne et il emporte toujours son appareil avec lui en randonnée. Il photographie les fleurs, les chalets, les marmottes, les lacs, les paysages.
Vers l’âge de 14 ans, on m’a offert un petit appareil photo. J’ai commencé à faire des photos pendant les vacances, au cours des randonnées. Mais je me suis vraiment intéressé à la photo vers 20 ans, au cours de mes études de philosophie. Je dessinais beaucoup quand j’étais enfant, puis la photographie s’est substituée au dessin par rapport auquel je ressentais une certaine frustration.
La photographie m’a permis de faire des images de manière plus immédiate, d’enregistrer ce qu’il y avait autour de moi, ce que j’avais du mal à faire avec le dessin. Le cinéma aussi a eu une influence. J’empruntais la caméra vidéo de la famille, j’ai acheté des caméras Super 8. La pratique de la photo était accompagnée par une pratique de filmage.
Au début, j’étais très influencé par le photojournalisme, j’avais des bouquins sur les photographes de Magnum ou la photographie humaniste française, Cartier-Bresson, etc. La découverte de la photographie est passée par les livres. Mon père avait une collection publiée par Life Magazine dans les années 1970. Il y avait à la fois l’histoire de la photographie, les grands auteurs, les techniques, les appareils, des dossiers thématiques : comment photographier la nature, comment photographier en couleurs. La lecture de cette collection, de manuels techniques, mais aussi les livres de photographies feuilletés chez les bouquinistes, m’ont donné de l’inspiration.
Quand j’ai commencé, je faisais des « natures mortes » un peu surréalistes. Je photographiais des choses que je trouvais dans les poubelles. J’essayais aussi de me rapprocher des gens et de faire des photos dans la rue.
Puis, j’ai fait beaucoup de photos de concerts, parce que je fréquentais des musiciens de jazz, notamment un camarade de lycée nommé Raphaël Imbert, bien connu aujourd’hui. J’ai aussi photographié des concerts de hip-hop à Aix-en-Provence où j’habitais. Je suivais un groupe qui s’appelait Nord Afrik. Mes premières images tournaient autour de la musique. Maintenant, je m’intéresse quasi exclusivement au paysage. Je pense qu’à l’époque, le paysage était un peu trop associé aux vacances en famille, je trouvais ça ringard.
La lecture des livres de photographies me permettait de me projeter dans différents styles que j’essayais d’imiter avec mes moyens d’amateur. Je pense aux natures mortes de Weston par exemple. J’avais une sorte d’idéal de la photographie qui était lié aux grands auteurs. Alors j’ai essayé d’entrer à l’École de photographie d’Arles.
Après vos études de philosophie ?
En licence. J’ai présenté Arles, mais j’ai échoué à l’oral. Pour la préparation du concours, il y avait un photographe au programme. Cette année-là c’était Berenice Abbott, photographe américaine qui a transposé la méthode d’Eugène Atget aux États-Unis en publiant un livre qui s’appelle Changing New York dans les années 1930, dans lequel elle photographie New York comme Atget photographiait Paris. Elle a aussi organisé l’édition des photos d’Atget, elle a acheté certaines de ses plaques et fait circuler son travail aux États-Unis. L’œuvre d’Atget a eu une influence importante sur le développement de la photographie documentaire américaine. C’est très visible chez Walker Evans.
Les photographies d’Eugène Atget m’ont énormément frappé. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j’ai eu à cette époque-là une fascination pour Atget qui m’a incité à me tourner vers la description des lieux, du décor urbain en particulier.
Un peu plus tard, j’ai consacré ma maîtrise aux textes de Walter Benjamin sur la photographie. Benjamin parle des photos d’Atget comme de documents historiques. Il écrit qu’Atget photographie la ville comme le lieu d’un crime. Parce qu’Atget photographie des lieux vides, il donne à voir un espace dans lequel l’historien peut chercher les indices d’une situation sociale.
À l’époque, je ne le comprenais pas de manière aussi fine. Mais les photos d’Atget m’ont amené à m’intéresser aux rues, aux places, aux façades. Cela en utilisant un moyen format.
Un jour un copain m’a appelé pour me dire qu’on vendait de drôle d’appareils à la Fnac du Centre Bourse. C’était des Lubitels, des appareils 6×6 en bakélite, fabriqués en Russie. Lubitel, ça veut dire « amateur ». Ça vient de liubov, qui signifie amour en russe. Un peu plus tard, j’ai acheté un Yashica Mat, puis un Rolleiflex. Mais j’adorais mon Lubitel.

L’œuvre de Walter Benjamin est fondatrice pour vous puisqu’elle vous accompagne depuis votre film Histoires nées de la solitude (2009).Elle est présente sous forme de citation dans votre premier livre de photos, Marseille, fragments d’une ville (2013). On la retrouve aussi dans votre essai Mais de quoi ont-ils eu si peur ? (2016). En quoi résonne-t-elle en vous ?
La rencontre de cette œuvre a été très importante. J’ai été intoxiqué à Walter Benjamin. Quand j’étais en philosophie, je voulais faire une maîtrise sur la photographie, mais je n’avais pas d’idée bien précise. J’ai discuté avec un professeur qui m’a dit qu’il n’y connaissait rien, qu’il savait à peine se servir d’un photomaton, mais qui m’a demandé si j’avais lu Benjamin. Je n’en avais jamais entendu parler. J’ai donc lu la Petite histoire de la photographie et L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, les deux textes où Benjamin parle de photographie, notamment d’Eugène Atget et d’August Sander.
Benjamin est un philosophe-écrivain. Il y a chez lui quelque chose qui a un rapport avec l’illumination. Quand on vient de textes philosophiques plus arides ou plus démonstratifs, on est saisi par le caractère poétique de son écriture. Mais il a aussi la particularité de s’être intéressé aux transformations de son époque, sous des aspects très concrets. C’est un philosophe qui écrit sur la littérature, la photographie, le cinéma, la ville, parfois à partir de sa propre expérience.
Il a écrit des descriptions de villes qui peuvent entrer en dialogue avec la photographie. Son écriture s’apparente à des poèmes en prose, dans un format assez court, lié au voyage, à l’observation de détails signifiants, à la transcription d’impressions sous la forme d’images. Ce sont les empreintes d’une expérience.
Au début des années 2000 à Marseille, j’ai travaillé comme assistant de Laurent Malone. Qui était à la fois éditeur et photographe. Son sujet de prédilection était la ville, qu’il photographiait à partir de la marche. En travaillant avec Laurent, j’ai rencontré Christine Breton, conservatrice du patrimoine, qui abordait la question du patrimoine à partir de la mémoire des habitants des quartiers nord. Ce travail était retranscrit sous forme de promenades ouvertes au public. Christine est quelqu’un qui réfléchit sur l’histoire : Comment écrire l’histoire ? Comment renverser les récits de fondation ? Comment écrire l’histoire de Marseille à partir de sa périphérie ? Non plus à partir des grands récits, mais de la mémoire populaire ? Elle s’inspirait beaucoup des textes que Walter Benjamin a écrit sur la tâche de l’historien. On s’est retrouvé autour de ces textes dans lesquels Benjamin dit qu’il faut prendre l’histoire à rebrousse-poil, c’est-à-dire écrire l’histoire à partir du point de vue des dominés, des révoltes réprimées, des utopies non réalisées.
La pratique de la promenade urbaine, que j’ai découverte avec Laurent et Christine, rappelle aussi les promenades de Walter Benjamin, héritier du romantisme allemand. Benjamin est quelqu’un qui, selon moi, prolonge l’activité de la promenade romantique dans la nature, qui commence avec Rousseau, mais la transpose dans la ville. La ville devient la nouvelle nature, le nouvel environnement qu’il faut apprendre à habiter.
À l’époque j’ai découvert que Benjamin avait écrit sur Marseille. Il y avait notamment un texte intitulé Faubourg, une description des quartiers industriels au nord de la ville, qui m’a énormément surpris. Dans ce texte écrit dans les années 1920, qui est un mélange de descriptions et de métaphores poétiques, j’ai retrouvé les impressions que j’avais eues en parcourant les collines des quartiers nord à presque un siècle d’écart.
C’est ce qui m’a donné envie de filmer Marseille en faisant dialoguer les textes de Benjamin et des vues de la ville. Ce film, Histoires nées de la solitude, dessine un parcours entre le centre de Marseille et les quartiers nord, depuis la rue de la République jusqu’aux hauteurs de Saint-Antoine. J’ai suivi une ligne qui était indiquée par Benjamin, mais qui correspondait aussi à mes propres explorations. J’ai eu la chance à cette époque-là d’apprendre à regarder Marseille à une très grande échelle, sans rester cantonné au centre-ville.
Ces marches dans Marseille m’ont amené à retrouver des sensations que je connaissais : celles de la randonnée. Marseille est une ville de collines, une véritable ville-paysage. J’ai fait la découverte incroyable que je pouvais randonner en ville, retrouver l’effort de la marche, son rapport au temps, à la vue, tout en m’inscrivant dans le quotidien de la ville, dans la multitude des faits que l’on peut observer. C’est là que j’ai vraiment commencé à m’intéresser à la photographie de paysage, ou du moins au paysage urbain.

Ce film, vous le finalisez quand vous quittez Marseille ?
Oui. C’était une manière de dire au revoir à la ville. J’avais décidé de partir à Paris, pour faire du cinéma avec des amis. Le cinéma m’intéressait autant que la photographie. J’ai du mal à penser la photographie comme une discipline à part. Pour moi, la photographie a toujours eu un lien avec une pratique amateur plus que professionnelle. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais la position de l’amateur est importante pour moi, être un peu à côté ou en dehors de la photographie et de ces conventions peut-être. Après tout je suis autodidacte, je n’ai pas de formation artistique, mais je me suis laissé entraîner par une nécessité un peu obsessionnelle, une passion contraignante, que j’associe à la liberté. Ce qui est paradoxal quand je fais des photos, c’est que je m’imagine en train de filmer. Ce que je recherche est proche de l’expérience de la promenade, qui résonne pour moi avec celle du cinéma, alors que la photographie est plus fragmentaire, immobile et silencieuse.
Bien souvent, vous mettez en résonance la photographie avec l’écriture.
Mon éducation littéraire a laissé des traces. J’essaie de concilier mon intérêt pour les textes et mon intérêt pour l’image, ce dont j’ai trouvé des exemples dans les films de Jean-Luc Godard ou de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, où la question du paysage est primordiale. J’ai travaillé de nombreuses années dans l’édition. Et j’ai même écrit un livre. Vers 2015, j’ai reçu un appel de Christine Breton qui me disait : « J’aimerais faire un livre sur Walter Benjamin et Marseille. Est-ce que ça te parait une bonne idée ? » Je lui ai répondu que non seulement c’était une bonne idée, mais que je voulais écrire ce livre avec elle.
Pour la voix-off de mon film, j’avais retraduit tous les textes de Benjamin. La traduction, le montage de textes sont des choses qui m’intéressent énormément. Depuis Histoires nées de la solitude, j’avais envie de publier un recueil des textes de Benjamin sur Marseille. Christine voulait que j’écrive une préface philosophique à son texte à elle, un récit où elle imaginait comment Benjamin avait perçu Marseille et en particulier la démolition du quartier de l’actuel Centre Bourse dans les années 1920. Nous nous sommes retrouvés à la Bibliothèque nationale de France pour consulter la correspondance de Benjamin avec Ernst Bloch et Siegfried Kracauer, deux philosophes qui étaient avec lui à Marseille en 1926. J’ai donc composé un recueil de textes de ces trois auteurs que j’ai traduits et commentés.
Benjamin disait qu’il voulait écrire l’histoire à partir d’un montage de citations. Les citations ressemblent aux photographies : c’est un cadrage dans un texte. L’essayiste John Berger a même écrit que la photographie est une forme de citation. On prélève un élément du réel. Dans Mais de quoi ont-ils eu si peur ?, le livre écrit avec Christine Breton (éditions Commune, 2016), je n’interviens pas comme photographe. C’est un travail de recherche, d’édition et d’écriture. La photographie est toutefois présente sous la forme d’un cahier d’images d’archives qui documentent les destructions de Marseille de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 1920.
À quel moment vous êtes-vous dit que vous étiez un artiste-marcheur, un photographe-arpenteur ?
Je n’ai jamais voulu me définir comme artiste-marcheur. Même si j’ai organisé des promenades urbaines, même si mon travail a un rapport avec la marche. Certes, il y a une histoire de la marche en tant que pratique artistique, mais pour moi la marche est une pratique commune, accessible à tous. C’est un moyen de se déplacer et d’aller voir. Photographe-arpenteur, je le suis par la force des choses, avec le fantasme d’une représentation exhaustive d’un territoire, d’un épuisement du lieu. Mais heureusement peut-être j’échoue, le monde est trop vaste. C’est là qu’intervient le montage, retrouver le tout à partir du fragment.
Avec Malone et Breton, vous avez retrouvé le plaisir de la randonnée en milieu urbain. Est-ce à ce moment-là que vous vous êtes dit que ça avait du sens pour vous, que vous alliez poursuivre cette exploration urbaine et que vous alliez en faire quelque chose ?
Je pense que je n’ai pas posé cela comme un projet. Quand j’ai découvert que la ville à grande échelle pouvait être un objet de contemplation, de réflexion, d’aventure aussi, que l’on pouvait voyager tout près de chez soi, ça a été un choc. Ça peut paraître banal aujourd’hui où la promenade urbaine est très pratiquée, mais ça a été une révélation. Cela m’a donné envie de prolonger cette pratique ailleurs, sans pour autant en faire un programme, me dire que ce serait ma manière de travailler. C’est un goût, un plaisir et une curiosité qui s’est affinée avec le temps.

Ce goût, vous l’affirmez dans votre premier livre de photographies, Marseille, fragments d’une ville. C’est quand même un positionnement.
Il y est question de figurer la ville par un montage de fragments. Le livre Marseille, fragments d’une ville est un prolongement de mon film. Les deux vont de pair, avancent en parallèle. Le tournage d’Histoires nées de la solitude date de 2004-2005, le livre lui a paru en 2013. Il recouvre 15 ans de photographies de Marseille. Je suis remonté jusqu’à des images que j’avais faites à la fin des années 1990. L’impulsion du livre c’était l’envie de faire quelque chose avec les photographies que j’avais accumulées, qui formaient un fonds qui me paraissait assez vaste à l’époque. Aujourd’hui, quand je vois le nombre d’images que je peux produire en numérique, ça dépasse de loin la quantité que j’avais sur Marseille. Mais je disposais d’un certain corpus établi au cours de mes promenades. Certaines images ont été faites sur des lieux que je suis retourné filmer. Le livre suit aussi un peu la même trame géographique que le film, partir du centre pour aller vers la périphérie. Il y a des variations, mais ça se ressemble. Le livre s’ouvre sur une citation de Benjamin que j’aime beaucoup.
« S’égarer dans une ville comme on s’égare dans une forêt demande tout un apprentissage. » Comment a été conçu le livre ?
Après avoir quitté Marseille et terminé le film, j’ai commencé à rassembler ces images et j’ai eu envie d’en faire un livre. Je me disais que c’était le meilleur moyen de les montrer. Je n’avais jamais fait d’exposition, mais j’avais une expérience dans l’édition avec Laurent Malone. J’avais fait la distribution et la diffusion de ses livres. J’avais aussi travaillé comme libraire, je connaissais ce milieu-là. J’y étais plus à l’aise que dans le milieu de la photographie, les enjeux n’étaient pas les mêmes. À l’époque où j’ai publié Marseille, fragments d’une ville, le livre de photos commençait à revenir à la mode. Dans l’édition littéraire, éditer à compte d’auteur n’est pas très bien vu, il manque la validation de l’éditeur. Tandis que dans le monde de la photo, autour des années 2010, l’auto-édition était un garant de rareté et d’authenticité. Le livre était considéré comme une œuvre à part entière, proche du livre d’artiste. Il devenait un objet désirable, phénomène qui a explosé depuis. Le livre est aussi un espace où l’on peut faire du montage, construire des séquences d’images, ce qui le rapproche du cinéma. C’est un objet assez analogue au film qui a un début, une fin, un parcours entre les deux. Ce corpus d’images sur Marseille n’avait pas d’ordre véritable. Je me suis dit que le livre permettrait de tracer des lignes, de passer d’une chose à l’autre, de proposer une promenade. D’y voir plus clair.
À Paris, j’ai retrouvé Florine Synoradzki, une graphiste qui avait fait un stage chez Laurent Malone et je lui ai proposé de travailler sur le projet du livre. Elle avait une maîtrise de la mise en page et une connaissance de la fabrication que je n’avais pas. Cette complémentarité était indispensable, je n’aurais pas pu faire le livre tout seul. Il y avait une envie très forte de sa part. Ça a rendu les choses possibles.

Pourquoi avoir pris la décision de l’éditer vous-même ?
Quand on a commencé à travailler, on avait l’idée de le proposer à un studio de design graphique qui éditait une collection de portraits de ville. Ils se sont montrés intéressés, puis ils ont changé d’avis. La solution de publier le livre nous-mêmes est apparu comme une évidence. Nous avions les compétences pour le faire et on savait ce qu’on voulait. Même si cela a fait l’objet de longues discussions. Ça n’a pas été facile de faire ce livre à deux, de construire un regard, d’arriver à un montage qui fonctionne en termes graphiques et qui corresponde à l’image que j’avais envie de transmettre, à ma vision de Marseille. Ça a représenté un gros travail.

Il y a combien d’images dedans ?
Une centaine. Aujourd’hui je trouve qu’il y en a trop. Mais il en reste que je n’ai jamais montrées. Pour imprimer le livre nous avons monté une campagne de financement participatif. Puis on a travaillé sur Waldersbach, mon deuxième livre, dans la foulée du premier. J’ai obtenu la bourse Brouillon d’un rêve photographie & dessin de la Scam, qui a servi à compléter le financement du premier. Le bénéfice des ventes a ensuite été reversé dans la fabrication du deuxième. On s’est débrouillé comme ça. Les deux livres ont très bien marché, même si l’auto-édition reste une économie précaire.

D’où vient le nom L’Astrée rugueuse ?
Florine m’a convaincu qu’il fallait un nom d’éditeur pour porter ce projet. J’ai pensé à ce petit porte-bonheur vendu sur le Vieux-Port que l’on nomme l’œil de Sainte Lucie. C’est ovale, orange, un peu nacré. Il s’agit de l’opercule d’un coquillage qui s’appelle l’astrée rugueuse. L’astrée, c’est l’étoile, une sorte d’idéal lumineux. Rugueuse, c’est la réalité. Cela me semble assez bien évoquer la photographie.
Vous avez publié deux livres avec L’Astrée rugueuse. Pouvez-vous me parler du second, Waldersbach ?
C’est l’adaptation de Lenz, une nouvelle de 1835, qui est un des derniers textes du romantisme allemand et qui reprend la figure du promeneur solitaire. Ce que les Allemands appellent le Wanderer, qui est à la fois le voyageur et le personnage errant. Lenz est un promeneur qui est à la limite de la perdition. C’est quelqu’un en proie à des crises de folie, qui marche dans les Vosges à la recherche d’un lieu où vivre en paix, et trouve refuge chez un pasteur du nom d’Oberlin.
Il s’agit d’une histoire vraie retranscrite par Georg Büchner, un écrivain de théâtre, dans les années 1830. Büchner a trouvé les carnets du pasteur qui raconte la visite de Lenz, qui était quelqu’un d’assez connu à l’époque. Quelqu’un qui parlait allemand, mais qui se déplaçait dans un territoire qui allait des pays baltes jusqu’à l’Alsace, la Mitteleuropa, un vaste continent européen de l’intérieur, traversé par la culture germanique de la nature, de la marche et de la poésie à laquelle je suis sensible.
J’ai découvert cette histoire en lisant L’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Felix Guattari, où il y a une phrase comme : « Mieux vaut la promenade du schizophrène que le divan du psychanalyste. » Un jour, je me suis retrouvé en Alsace, vers le mont Sainte-Odile. J’ai repensé au texte de Büchner et je me suis demandé où se trouvait le village où se déroule cette histoire, qui se nomme aujourd’hui Waldersbach. J’avais lu la nouvelle sans penser au lieu. En découvrant le paysage des Vosges, j’ai réalisé que l’histoire de Lenz se déroulait dans ces ambiances de neige, de roche et de forêt. J’ai eu envie d’aller voir à quoi ressemblait le village et comment cette histoire d’errance et de folie résonnait avec le lieu aujourd’hui.

Je suis parti un hiver avec appareil photo et caméra, ne sachant trop ce que j’allais faire, plutôt avec l’idée d’un repérage de film. J’ai exploré la vallée où se déroule la nouvelle. J’ai rencontré des habitants. Je suis allé voir le musée Oberlin, qui est l’ancien presbytère du pasteur. Puis j’ai commencé à travailler sur l’histoire du paysage des Vosges, pour comprendre comment il avait évolué. C’est quelque chose qu’on va retrouver dans mon travail actuel sur Athènes. L’envie de comprendre l’évolution des paysages : Comment c’était autrefois ? De quoi est fait le paysage d’aujourd’hui ? Comment est-ce qu’on projette une fiction dans un paysage ? Comment on se représente le monde dans lequel on vit ? De quelle histoire on hérite à travers le paysage ? Ce sont des questions qui sont aussi très présentes dans la promenade urbaine.
En parallèle, j’ai travaillé sur le texte. C’est une nouvelle assez courte, inachevée. Il y a beaucoup de descriptions, de projections d’images mentales dans les paysages. Je me suis demandé comment mes photographies pouvait tenir face aux images présentes dans le texte. J’ai procédé à un découpage du récit à l’intérieur duquel j’ai tracé un cheminement à partir de fragments. Il fallait trouver un détail de l’image qui rappelle un détail du texte, ou bien un contrepoint, quelque chose qui fait qu’on n’est pas sur le même plan, mais qu’une relation puisse apparaître.

Ne pas être forcément dans l’illustration ?
La photographie ouvre un espace où l’on peut se projeter en lisant. J’aime beaucoup l’idée de se projeter dans une image comme on se projette dans un paysage. C’est quelque chose qui me fascine, l’idée de pouvoir entrer dans un tableau, se promener dans une image. Comme pour le premier livre, j’ai travaillé avec Florine. Je me suis également dit qu’il me fallait des appuis pour ce projet. Je suis allé à la rencontre de Jean-Christophe Bailly parce que je savais qu’il avait un attachement particulier à ce texte. Bailly est philosophe, écrivain, poète, mais il a aussi travaillé comme éditeur. Lenz est le premier livre qu’il a publié. Connaissant son intérêt pour la photographie, le romantisme allemand, Walter Benjamin et le paysage, j’ai pensé que c’était quelqu’un à qui je pouvais m’adresser. À la fin d’une conférence, je suis donc allé lui parler. Je lui ai montré une maquette, il l’a feuilletée et m’a dit qu’il allait m’écrire un texte. Je ne m’y attendais pas du tout ! Je n’aurais même pas osé le lui demander. J’attendais juste une validation, qu’il me dise que je n’avais pas fait trop de bêtises.

Ce texte a été un sésame pour aller chercher d’autres partenaires. J’ai obtenu une bourse de la Scam, la Fondation Jan Michalski a soutenu le livre. Je suis allé voir le Goethe-Institut, j’ai établi tout un réseau. Comme pour Marseille, fragments d’une ville, j’ai assuré seul la distribution, je suis allé voir les libraires, j’ai organisé des rencontres et le livre s’est bien vendu. Il y a eu une exposition et une journée de rencontre avec Jean-Christophe Bailly et Rodolphe Burger à la Fondation Jan Michalski, le livre a été présenté au Fotobook Festival de Kassel dans la sélection des meilleurs livres de l’année, grâce à Sebastian Arthur Hau, qui dirigeait alors la librairie du BAL à Paris. Quand j’y repense, c’est fou. C’est formidable ce qui s’est passé autour de ce livre.
Pour revenir à des choses un peu plus proches temporellement, j’aimerais que vous me parliez des projets récents comme L’Étang moderne avec Camille Fallet, qui a été exposé dans le cadre du festival Photo Marseille 2024, et Les Ruisseaux d’Athènes.
Je vais faire une petite généalogie. Quand je suis arrivé à Paris, j’ai laissé de côté la promenade urbaine. Je connaissais mal la banlieue parisienne, où je n’avais aucun repère. Je revenais à Marseille pour me balader. Au moment de la création du GR 2013, j’ai rencontré Jens Denissen qui faisait partie de l’équipe qui conduisait les repérages. Il est monté à Paris et quelques années plus tard, avec l’association Le Voyage métropolitain, nous avons organisé des promenades urbaines. J’ai ainsi découvert la richesse de la banlieue parisienne. Comme j’étais très impliqué dans l’organisation, il était difficile de réaliser simultanément un travail photographique. J’ai participé aux repérages du Sentier du Grand Paris, équivalent du GR 2013, et certaines de mes photos ont été exposées au Pavillon de l’Arsenal, dans le cadre de l’exposition « L’Art des sentiers métropolitains » en 2020.
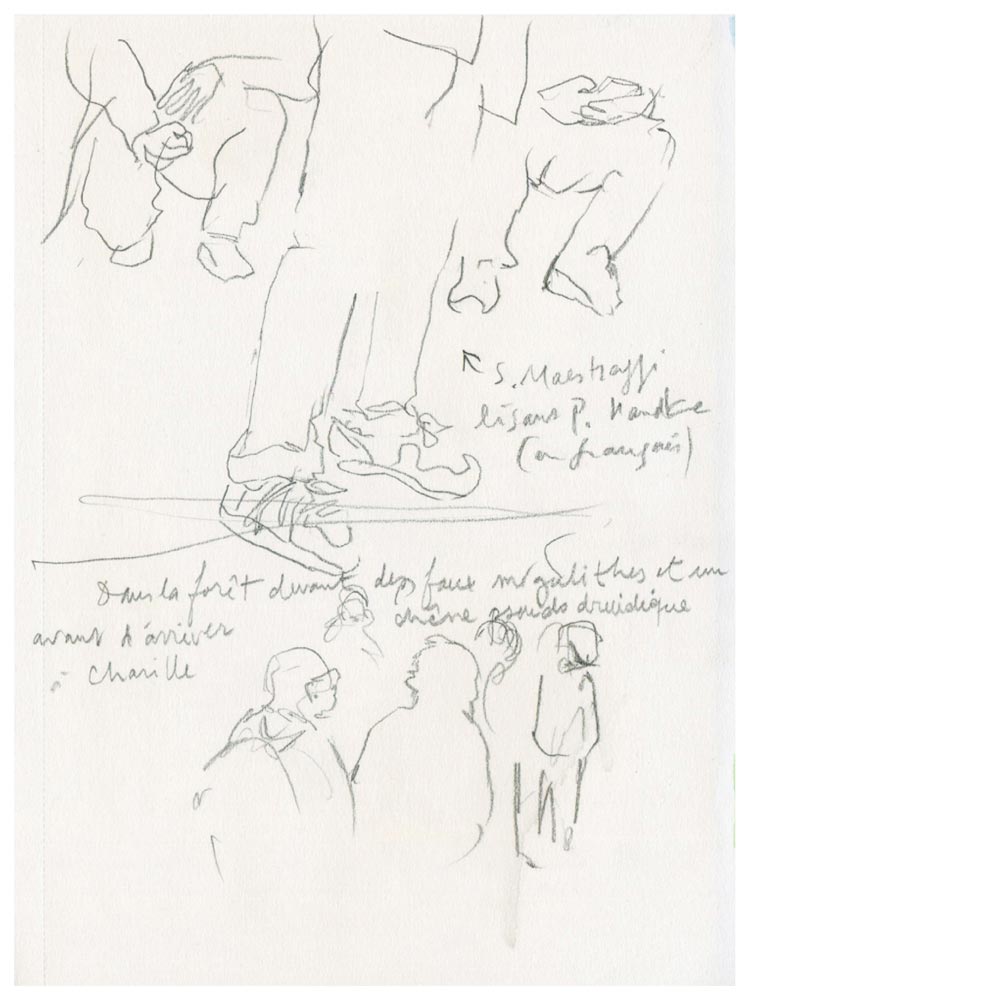

Après une période intense consacrée à l’édition, ces promenades ont ravivé mon intérêt pour l’exploration, la lecture des cartes, l’histoire des territoires.
À cette période-là, quand je redescendais dans la région, j’en avais assez d’atterrir à Marseille. J’ai commencé à refréquenter les lieux de mon enfance. Je suis né à Marseille, mais j’ai grandi à Aix et mes grands-parents habitaient Saint-Chamas. Je me suis mis à redécouvrir ces lieux, qui sont plutôt des lieux périurbains ou proches de la campagne et j’ai fait des séries de photos autour d’Aix et le long de la D10, la route qui va d’Aix à Saint-Chamas. J’avais envie de revoir le paysage que j’avais connu enfant, à la fois pour retrouver des souvenirs, mais aussi pour comprendre de quoi ce paysage était fait. J’aime beaucoup une phrase du photographe Robert Adams qui dit que l’art du paysage consiste en « une redécouverte et une réévaluation des lieux où nous nous trouvons ».
Quand on passait au-dessus de l’étang de Berre, je me souviens très bien qu’enfant je ne comprenais pas ce que c’était que cet étang. Je me demandais si c’était la mer. J’avais toujours un doute sur cette étendue immense, mais fermée. Mes oncles et tantes parlaient de la pollution de l’étang de Berre. C’était un lieu maudit, avec des usines au loin. Il ne fallait pas s’y baigner. C’était un lieu pollué et sans avenir. Chez mes grands-parents, c’était autre chose. C’était la colline. Ces séries sur Aix-en-Provence et la D10 ont été exposées par Camille Fallet à l’Arthothèque de Miramas, sous le titre Suite départementale, et plus tard intégrées au site inventaire.net consacré à la photographie de paysage sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille.

En 2020, après le premier confinement, j’ai participé à une promenade du Bureau des Guides du GR2013, qui menait un projet autour de l’étang de Berre. Alexandre Field m’a dit qu’il voulait passer commande à des photographes de travaux sur ce territoire. Il avait proposé à Camille Fallet qui tardait à lui répondre. Je connais très bien Camille depuis des années et nous avions déjà parlé de faire un projet ensemble. Je l’ai donc appelé pour lui soumettre l’idée de travailler ensemble. Et voilà maintenant trois ans que nous faisons le tour de l’étang de Berre ! C’est un territoire difficile à qualifier, anciennement rural devenu industriel. Un aménagement qu’on pourrait qualifier de périurbain ou d’urbanisme de banlieue, qui jouxte les cabanes de pêcheurs et les anciennes bastides. Un territoire fragmenté, très abîmé. Mais où l’on trouve des traces archéologiques anciennes, de la préhistoire à l’occupation romaine, qui subsistent parce que l’espace reste ouvert, qu’il y a des friches, des forêts, des collines. Un site naturel spectaculaire, dont le pittoresque est complètement sous-estimé. Un territoire réputé pour ne pas avoir d’histoire, et qui a été considéré comme vide et disponible pour la conquête industrielle. À la manière de Christine Breton, j’ai eu envie de prendre ce discours à rebrousse-poil, et de partir à la recherche des traces qui témoignent de son histoire, même si elles le font ressembler à un champ de bataille. Le travail avec Camille a commencé par un repérage en numérique avec chacun un appareil, mais aujourd’hui nous travaillons à la chambre photographique en composant les images ensemble.

Vous étiez ensemble pendant la phase de repérage ?
Nous travaillons en binôme depuis le début. On part en voiture. L’étang n’est pas très loin de Marseille. On y passe une ou deux journées par mois. Au début, nous étions financés par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), qui nous a demandé, par l’intermédiaire du Bureau des Guides, de constituer un fonds d’images qui devait servir au dialogue entre les acteurs du territoire dans les questions d’aménagement, de cohérence entre les dires de l’État et les projets de la Métropole. Nous sommes intervenus dans des réunions techniques, pour apporter une expérience du terrain. Cette phase nous a permis d’explorer ce très vaste territoire et de repérer les lieux que nous photographions aujourd’hui à la chambre. Camille est un expert de la chambre 4×5, moi j’ai beaucoup photographié au moyen format, mais j’ai peu d’expérience à la chambre. On travaille en composant l’image à deux. Chaque image est le produit du dialogue que nous menons depuis le début. Le large dépoli de cet appareil grand format permet véritablement de partager le point de vue. Nous travaillons de mémoire. Nous avons identifié des lieux, mais nous ne les avons pas pointés sur une carte, nous n’avons pas dressé d’inventaire. C’est la relance d’un travail qui s’improvise autour des endroits qui nous ont marqués. Nous revisitons des lieux et parfois nous photographions des choses que nous n’avions pas vues.
Ce projet a été présenté chez Zoème, à la fin de l’année dernière, à l’invitation du festival Photo Marseille. Mais le travail n’est pas tout à fait fini. Nous avons repris les prises de vue en début d’année.
En parallèle, je mène un travail photographique sur les rivières de la ville d’Athènes. Il y a une dizaine d’années, j’ai commencé à m’intéresser à l’histoire de la Grèce, de l’Empire Byzantin et de l’Empire Ottoman. J’ai visité Athènes, Delphes et les Cyclades, j’ai fait un voyage entre Istanbul et Thessalonique. Puis j’ai eu l’occasion de retourner à Athènes grâce à Jordi Ballesta, un photographe, ami de Camille, qui vivait là-bas. Jordi a travaillé sur l’habitat vernaculaire, sur l’histoire de l’Athènes contemporaine et il connaît très bien la société grecque. Un point de vue décalé par rapport à celui du voyageur qui cherche à retrouver l’Antiquité dans la Grèce actuelle. J’ai été surpris par cette ville que je ne comprenais pas. Une fois sorti des sites archéologiques, je n’avais aucun repère pour m’y déplacer. En grimpant sur les collines, j’ai observé l’immensité de la ville, qui forme une marée de toits plats montant à l’assaut des massifs. Pour élucider ce mystère, j’ai décidé de faire de grands parcours à pied, en m’éloignant du centre. Au cours d’une longue marche dans le nord de la ville, je suis tombé sur un ravin qui me barrait la voie. C’était dans une zone maraîchère, non loin d’un aéroport. De l’autre côté, la ville reprenait. Avec la chaleur qu’il faisait, c’était en été, je ne m’attendais pas du tout à trouver un ravin aussi verdoyant. Il y avait de grands arbres, une végétation abondante : c’était le lit du Kifissos, le fleuve principal d’Athènes.

Athènes est située dans une vaste plaine entourée de collines. Des rivières autrefois très nombreuses, seule une dizaine est encore visible. Toutes étaient des affluents du Kifissos. Autour de ce fleuve, de l’Antiquité jusque dans les années 1940, il y avait une oliveraie, des vignes, des potagers. Toute cette plaine a été transformée en zone industrielle, puis recouverte par la ville. Au cours du 20e siècle, avec le développement urbain, il a fallu trouver une solution aux problèmes de malaria et aux inondations saisonnières. Les rivières ont été enterrées, recouvertes par des routes, transformées en système d’évacuation des eaux. Mais avec l’imperméabilisation des sols, les incendies et les fortes pluies dues au réchauffement climatique, la menace des inondations n’a fait que s’accroître. Certains habitants militent pour la protection et la réouverture des rivières, pour des modes d’aménagement plus écologiques que les pipelines de béton que l’on continue à creuser. Ce qui m’a intéressé, c’est le rapport de la ville avec son site naturel. Athènes est considérée comme le berceau de la civilisation occidentale, cette histoire est une construction qui s’appuie sur la mémoire portée par les monuments archéologiques. Selon moi les rivières sont porteuses d’une autre mémoire, qui a été négligée et recouverte, une mémoire naturelle, terrestre, qui se rappelle à nous à travers le changement climatique. Les rivières sont des chemins qui indiquent une voie pour explorer la ville et son histoire. On en trouve des témoignages dès l’Antiquité, chez Platon ou Sophocle. Mais ce qui a été valorisé par l’histoire, c’est l’architecture et non le territoire qui la porte. On a conservé des vestiges archéologiques, mais les rivières qui formaient le paysage autour de ces vestiges n’ont pas été préservées. Je me suis demandé si elles pouvaient être vues comme les traces d’une mémoire oubliée. Cela permet d’écrire une autre histoire, à partir des indices laissés dans les textes anciens, les récits de voyageurs, les documents d’archives, qui peuvent entrer en dialogue avec les photographies du paysage aujourd’hui. Ces indices mis bout à bout font émerger une autre image du territoire, en résonance avec la question écologique. Ce n’est pas sans rapport avec le travail que nous faisons avec Camille autour de l’étang de Berre.
Ce projet, toujours en cours, a donné lieu à une première exposition chez Zoème fin 2022, avec mes premières photographies, et nous préparons actuellement un livre, Soraya Amrane, Rafael Garido et moi-même, qui paraîtra en septembre chez Zoème, dans la collection Cahiers.
Le projet est aussi accompagné par un travail de recherche plus académique, même si je ne suis pas universitaire. J’ai présenté ma démarche à l’école d’architecture de Marseille et à l’Université de Gênes dans un programme sur les rapports entre photo, texte et paysage. Comme toujours, les prises de vue photographiques sont accompagnées de vidéos. Et j’espère un jour publier un livre accessible aux Athéniens. Bref, je n’en ai pas fini avec les rivières. Comme le dit une amie grecque, citant un vieux rébétiko : « Je suis comme ensorcelé ».





![[ ENTRETIEN ]
Géraldine Lay L'œil et la page, un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 Lien dans la bio
Photographe et éditrice chez Actes Sud, Géraldine Lay avance guidée par ce qui l’anime : les rencontres, les lieux et les personnes. Son parcours se construit dans un équilibre fertile, nourri par cet aller-retour constant entre accompagner les œuvres des autres et poursuivre sa propre exploration du monde.
📷 The North End, Géraldine Lay, Courtresy Galerie Le Réverbère](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
