Michèle Sylvander En conversation

Depuis plus de 30 ans, Michèle Sylvander explore au travers de ses œuvres les notions d’identité et de genre, entre réalité et fiction. Dans un propos où le personnel rejoint l’universel, elle donne forme à ses images mentales par la photographie, la vidéo et par le dessin.
Propos recueillis par Christophe Asso
Quel est votre parcours ? Comment en êtes-vous venue à l’image et à la photographie ?
Mon père était officier. J’ai eu une enfance faite de déménagements, au gré de ses affectations, à l’heure où le Maroc et l’Algérie étaient encore des colonies françaises. J’avais une vie nomade. J’ai passé une partie de ma petite enfance en Allemagne. Ma mère qui n’était pas prédestinée à faire de la photo et qui n’avait pas cette culture, nous photographiait tout le temps avec mon frère et mes 2 sœurs lorsque nous étions enfants. Elle nous cernait avec un appareil photo qu’on lui avait offert. Elle peignait aussi des petits tableaux assez particuliers, parfois même directement sur les murs de nos chambres, ce qui nous laissait tous assez perplexes. Elle constituait surtout des albums de famille dont je me suis servi beaucoup plus tard dans mon travail. D’ailleurs, j’ai manqué de l’attention affective que méritait ses «archives». Quand j’ai découvert qu’elle avait des photos vraiment intéressantes, je me suis servi de ses albums sans le moindre ménagement. Je pense qu’elle ne m’en a pas voulu, malgré tout.
Quand j’ai annoncé à mes parents que je voulais m’inscrire aux Beaux-Arts, ils n’étaient pas vraiment enchantés mais ils m’ont laissé faire. Je me suis inscrite à l’école de Marseille en 1962. J’avais déjà fait un an aux Beaux-Arts à Toulouse. Ce qui a été déterminant pour moi quand je suis arrivée à Marseille, c’est d’avoir rejoint rapidement l’atelier de François Bret, qui était à la fois peintre et à la direction de l’école, où j’ai assez vite commencé à peindre moi-même. C’est là que j’ai rencontré Marie-Christine Bret, sa fille, mariée plus tard à Roger Pailhas qui allait devenir mon galeriste pendant plus de 10 ans. C’est aussi là que j’ai rencontré Harald, mon mari qui était étudiant en architecture. Notre fils Raphaël est d’ailleurs né alors que nous étions encore tous les deux à l’école.
J’ai peint, jusqu’en 1985. Je suis née en 1944, donc en 1985, je n’étais pas toute jeune. J’ai eu une crise difficile. Je n’arrivais plus à travailler. Je ne trouvais pas de réponses aux questions que me posait la peinture. Je me disais que je n’arriverais jamais à les surmonter.
En 1985, on avait acheté avec Harald un grand local sur le Quai de Rive-Neuve, qui était en travaux que j’ai investi comme atelier. Je me suis dit que j’allais être complètement libre et que je ne m’imposerai rien. J’ai commencé à peindre sur les sols de l’appartement, sur les murs, sur des morceaux de bois. Je fabriquais des objets avec du papier journal ou de la terre. Je les posais au sol avec d’autres objets trouvés par hasard. Avions, bateaux, comme pour un grand voyage immobile. J’avais besoin, avant de détruire ces installations, de garder leurs traces, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à avoir besoin de me servir de la photographie. Tout ce qui m’entourait dans l’atelier devenait un prétexte pour réaliser des images nouvelles, de l’évier jusqu’au jeux d’enfants que j’avais gardés, comme celui des osselets par exemple, éléments évidents du corps humain, qui allaient peu à peu diriger autrement mon travail.

100 x 120 cm © Michèle Sylvander
Un jour, Roger Pailhas m’a demandé où en était mon travail. Je lui ai dit : «Je ne sais pas. Je pense que ce n’est rien, mais ça m’amuse. C’est jubilatoire, ça me redonne du désir.» Il a voulu voir, a trouvé ça bien, et voulu l’exposer. C’est comme ça que tout a commencé.
Ces images sont une sorte de semi-rupture avec la peinture, en même temps qu’une ouverture à la photographie. Pendant la période à laquelle je me consacrais à la peinture, j’ai eu aussi des ruptures dans les expressions formelles que j’utilisais. J’ai commencé par une peinture que je pourrais qualifier, tout au moins un moment, d’expressioniste, plutôt violente, que d’aucuns qualifiaient bêtement de travail de “mecs.” Plus tard, dans la forme que prenait ma peinture, je pense qu’on pouvait déjà percevoir ma relation à la photographie. Je dois ajouter que je ne me suis pourtant jamais vécue comme une photographe, ce qui demande un savoir-faire que je n’avais pas. J’ai commencé à me servir de ce médium en multipliant les expériences comme beaucoup d’artistes le faisaient à ce moment-là. La photographie du plongeur que j’ai réalisée en 1991 est vraiment un objet intermédiaire entre la peinture et la photo. J’avais reçu une carte postale, portant au dos : Dalle de la couverture de la tombe du plongeur de Paestum, 480 avant Jésus-Christ.
J’avais déjà vu bien sûr des reproductions des peintures de la tombe du plongeur, trouvées lors de fouilles archéologiques, mais c’est en recevant une carte postale de couleur jaune pâle traversée d’une diagonale ocre évoquant un plongeur suspendu dans le vide, que j’ai été complètement séduite par son archaïsme troublant et sa grande modernité. Sa forme très épurée s’est inscrite de façon ludique dans mon travail pendant quelques mois. Je l’ai découpé, métamorphosé, anamorphosé, multiplié, posé sur une grande aquarelle de mer pour finir par le photographier à maintes reprises. Laisser sans les séparer dans un mouvement répétitif toutes les photos de ces images, m’est apparu comme une évidence. Au final, la photo se montre en découpes séquentielles comme pour un film.

C’est une pièce qui a été achetée par le Frac Paca, ma première relation avec les institutions. Dans mon travail, il y a très souvent une relation avec l’eau ; dont j’ai peur à présent, ce qui est très bizarre dans la mesure où plus jeune j’aimais beaucoup me baigner. Mon travail sur le jeu, associé à celui des osselets, m’a conduite à un travail plus directement lié au corps comme celui de mes autoportraits par exemple.
Sur le site Documents d’artistes, les premiers travaux photographiques qui apparaissent, ce sont les autoportraits, et d’autres travaux fondateurs, datés de 1995.
Ce sont, à mon avis, mes photos les plus emblématiques. Je peux dire que j’ai deux sortes de photos : celles que j’expose et que je considère les plus emblématiques de mon travail et celles que j’appelle pulsionnelles. Prises sans but précis et sans la moindre idée, tout au moins consciemment. Elles sont parfois comme des esquisses pour un travail à venir. Des sortes de dessins préparatoires.
C’est en effet dans les années 1995, que la question du genre et de l’autoportrait se sont inscrits dans mon travail. Ma rencontre avec Elisabeth Montagnier, photographe, a été importante. C’est elle qui a fait les prises de vues de mes autoportraits et contribué par la suite à d’autres prises de vues de mes travaux.
La question du genre était déjà présente dans le champ de l’art dans les années 70/80, avec des artistes comme Carolee Schneemann, Valie Export ou Cindy Sherman ou ORLAN et bien d’autres. Sans oublier la comtesse de Castiglionne au XIXe siècle qui se faisait photographier par son psychiatre Clérambault dans des tenues extravagantes, elle aussi dans le mystère de la représentation du corps sans pour autant être perçue comme «artiste». Je constate que depuis quelques années, ce sujet est fort réactualisé par de nombreux jeunes artistes. Tout en étant attentive aux travaux de Cindy Sherman de Valie Export ou d’autres, je peux constater que les démarches se différencient même si le corps de chacune est utilisé comme support à la représentation.
Ce sont les choix, même les plus anodins, qui nous permettent de trouver notre propre univers formel et sa singularité, en se tenant le plus éloignés possible des codes référencés. D’une certaine façon, j’ai plutôt une relation “addictive” à la photographie. J’ai une centaine de cartons remplis de photos que je prends aussi dans mon appartement, de mes amis, de ma famille, comme le faisait ma mère. J’ai eu longtemps le projet, jamais totalement abouti de confronter les photos prises à chaque Noël pendant des années, et donner à voir l’absence de ceux qui nous quittent et de ceux qui vont à leur tour affronter la vie. Ce rapport à la mort est très fort chez moi, comme chez tant de photographes.
Vous dites que la photographie est un moyen de reproduire vos images mentales. Il y a des autoportraits mais aussi des images où vous vous mettez en scène. Vous parlez de portraits intermédiaires. Est-ce de l’ordre de l’allégorie ? Il y a une dimension universelle dans vos images et un élément qui revient beaucoup. J’aimerais que vous m’en parliez. C’est la chemise blanche.
Si vous parlez en particulier de la chemise blanche posée seule comme sur un présentoir. Je peux imaginer qu’il peut, peut être, s’agir de celle de mon père. Je ne sais pas vraiment. Quand on fait les choses, l’inconscient fonctionne aussi. On ne maîtrise pas tout, même si on fait la tentative de le faire. Les explications surviennent après. C’est cependant pour moi une image d’absence. C’est aussi un vêtement assez banal, aussi bien porté par les hommes que par les femmes.


Quand vous faites La fautive, est-ce une manière de vous grimer en votre père ?
Non. C’est un regard sur l’identité de chacun. J’ai réalisé cette photo très simplement. C’est en me coiffant, que j’ai enlevé une touffe de cheveux de ma brosse que j’ai ensuite collée pour m’amuser, sur ma poitrine. Je connaissais ce mot d’argot pour dire cheveux : les tifs. Sur moi il s’agissait de faux tifs. Le titre La fautive vient de ce jeu de mots. La fautive renvoie bien sûr à d’autres interprétations qui interrogent l’identité entre autres, mais aussi la culpabilité.
Vous dites que l’art est une consolation et que les enfants de militaires vivent sans trouver leur juste place dans le monde.
Oui, mais il s’agit de deux choses différentes qui se rejoignent. Je suis d’un naturel plutôt pessimiste. Je gère plus ou moins bien les angoisses auxquelles nous sommes à peu près tous confrontés. L’art me fait réellement du bien et me console. En ce qui concerne les enfants de militaires dont je fais partie, et qui sont de ma génération, nous sommes en quelque sorte sans racines, trimballés d’un pays à un autre, selon des événements qui ne nous appartiennent pas. Je n’ai jamais eu le temps de me lier à un ou une élève qui partageait ma classe par exemple. C’était difficile de connaître sa juste place. C’est une impression inconfortable, celle d’avoir le cul entre deux chaises, avec un père le plus souvent absent, et une mère qui compensait son vide en peignant des “œuvres” fortement négligées par son mari, cela va sans dire. Cet écart si fort entre eux a abouti à un projet que j’ai réalisé au château de Servières en 2015, À mon retour, je te raconte, une phrase trouvée au dos d’une carte postale. Cette exposition, qui à mon avis était assez réussie, a été organisée avec Martine Robin qui a scénarisé l’exposition en deux parties. Celle du père d’un côté, et celle de la mère de l’autre. Une collaboration formidable empreinte d’amitié et de compréhension, bien que Martine soit d’une autre génération que la mienne.


Vous dites : « L’intime est lié à la question de la mort et de la confiance ». Vous aviez des angoisses d’adolescente qui étaient liées au fait de confier votre mort à quelqu’un. Pouvez-vous m’expliquer ce que cela signifie ?
C’est Jérôme Sans qui m’a posé cette question sur l’intimité à laquelle je lui ai répondu que dans mes performances, ça ne me posait pas trop de problèmes de me déshabiller, mais par contre, que je ne pourrais pas me brosser les dents devant lui. Quand j’étais jeune, je pensais souvent à la disparition de mes parents. Ce qu’on allait faire de mon corps à ma mort me préoccupait. Je me souviens en avoir plus tard parlé avec Judith Bartolani qui avait le projet de demander à qui le voulait de lui confier leur corps après leur mort. Avec le temps, ceci étant dit, je vois les choses différemment.
Pour la collection de cartes Photorama, vous avez souhaité utiliser une photographie de votre père faite par votre mère.
Il s’agit de la photo prise par ma mère la plus importante pour moi. Sur celle-ci, mon père, habillé en militaire, tient une poupée que ma mère lui a glissée dans les bras pendant sa sieste. Une sorte d’intimité familiale s’en dégage, mais aujourd’hui je pense qu’inconsciemment ma mère cherchait avec une certaine ironie à se moquer de mon père et aussi du milieu militaire dont, d’une certaine façon, elle préférait se tenir à l’écart.

Elle avait par exemple “détourné” de leur usage, des dessous de manteaux de l’armée de mon père sur lesquels elle cousait des galons de couleur pour nous les donner comme vêtement. On les portait avec plaisir avec mes sœurs. Manteau que j’ai photographié et exposé.
Par ailleurs, l’exposition du MAC en 2002, Un monde presque parfait, est construite avec les photos que ma mère avait elle-même stockées. J’ai opéré une intrusion dans ses albums et sélectionné une douzaine d’images aux cadrages les plus surprenants. Je n’avais comme modèle esthétique que le sien. J’ai eu besoin de faire «rejouer» par de nouveaux protagonistes ses images. Les membres de la famille de mon mari ont accepté de se prêter à ce jeu de rôles.

Peut-être qu’il s’agissait de ne pas utiliser directement les images de ma mère même si je les trouvais belles. C’est un peu comme si elle avait écrit une pièce de théâtre que je pouvais interpréter avec d’autres comédiens. Ces souvenirs enfouis qui resurgissaient, ressemblaient à une sorte d’enquête sur leur vie et aussi sur la relation que nous avions avec eux. Pour tout dire, au début je me suis sentie parfois très mal à l’aise. C’était une sorte de répétition ambiguë avec ce que cela comporte. Répéter, représenter, est bien ce qui constitue toute recherche.
Michel Poivert, à propos de votre travail, parle du retournement. Je le cite : « Ce moment de la vie où plus rien ne sera désormais appris, mais compris ». Cela correspond-il à ce moment où vous découvrez ces archives et tentez de comprendre la relation entre votre père et votre mère.
On ne comprend jamais vraiment. Ma rencontre en 2010 avec Michel Poivert est très importante pour moi. Il était invité à faire une conférence à l’École des Beaux-Arts de Marseille, au moment où je travaillais là-bas. Une conférence magistrale comme il sait si bien le faire. À un moment, très rapidement, il a cité mon nom. On ne se connaissait pas du tout. J’étais très émue et je suis allée me présenter à lui. C’était un peu comme s’il me faisait une petite place dans ce vaste monde de la photographie. Plus tard, nous devions avoir un projet ensemble dont il était le commissaire. Un projet qui n’a pas abouti. C’est alors qu’il a eu l’idée d’une revue, qui s’est elle-même transformée par la suite en un petit carnet de dessins dont il a écrit des textes fictionnels assez décapants : un joli objet prénommé Juste un peu distraite, édité par Bik et Book en 2020. Le dernier livre de Michel Poivert, que je viens de lire, Contre-culture dans la photo contemporaine, m’a renvoyé au côté expérimental de mes débuts.
Michel Poivert, toujours à propos de votre travail, parle d’inversion tandis que Jérôme Sans évoque un entre-deux.
Je pense que Michel Poivert évoque là mes portraits impossibles. Je parle de ceux de dos. Le dos fait obstacle. On est hors du regard des autres. C’est le dos qui devient l’objet de la photo. Là encore, l’absence est peut-être la clé de ses postures, de l’envers, de l’endroit, comme pour les photos C’est une fille et Elle aussi.


L’entre deux est peut-être celui de mon impossibilité à définir vraiment ma place. C’est une situation qui fait partie intégrante de mon histoire. Je n’aime pas les repères fixes, je me sens toujours à côté. Je ne ferai pas le travail que je fais si ce n’était pas ainsi. Je n’ai d’ailleurs jamais provoqué ce qui m’a été proposé dans mon travail par exemple. Tout est arrivé simplement.
Provoquer. Je voudrais qu’on parle du côté transgressif de votre travail. Quand vous avez eu accès aux archives familiales, vous dites que finalement, vous aviez accès à une zone intime qui vous était interdite.
Une photo arrachée dans un album devient plus anonyme. Elle fait partie des images qu’on pourrait appeler “dérobées” ou “ trahies”, un peu les deux, finalement. Le passé-présent était de toute façon pour moi, un alibi. Je réalisais une sorte d’enquête et accumulais des indices enfouis, éprouvés ou manqués. Il ne s’agissait pas seulement de reconstituer l’image d’une image mais de m’interroger sur l’espace entre ces deux images. C’est le mystère qui entoure ce qui va subsister de la première image qui m’intéresse. Rien de nouveau ne peut être résolu.
Les dix photographies qui constituent Un monde presque parfait sont le résultat d’une reconstruction par pulsations successives, sans commencement ni fin. L’histoire est un trouble permanent et l’imitation peut déclencher des émotions fortes. Ces allers retours intrusifs m’ont parfois mise mal à l’aise et parfois triste aussi. Les images rejouées sont semblables mais pas identiques aux images d’origine. Il en résulte une interaction ambigüe et énigmatique entre biographie et fiction, entre passé et présent.
Quand j’ai fait mon exposition au château de Servières, mes parents avaient disparu tous les deux, j’avais moins de pudeur à entrer dans leur monde.
Effectivement il y a une partie de votre travail qui concerne votre père. Il y a aussi une partie importante sur votre mère, qui est peut-être venue après. Est-ce votre mère que l’on voit de dos sur la photo “Un jour mon prince viendra” ?
Oui, une ou deux années avant sa mort. Elle m’a appelée en me demandant de venir chez elle. Elle se trouvait ridicule après qu’une aide soignante l’ait coiffée comme une petite fille, une natte tressée au dos derrière la nuque. Avec ses cheveux gris, je l’ai trouvé terriblement émouvante. Je l’ai photographié avec mon portable. Une image techniquement très imparfaite qui me touche cependant beaucoup. En fait, mon travail d’archives a débuté avec ma mère, celui avec mon père a suivi beaucoup plus tard.

Pourquoi ce titre “Un jour mon prince viendra” ?
On a toujours dit aux petites filles : « Tu verras, un jour ton prince viendra. » Ma mère avait 91 ans. C’est comme si elle s’était préparée pour recevoir le sien. Ça m’a amusée de lui donner ce titre. Les titres sont importants pour moi.
Vous avez également une pratique photographique au quotidien.
De façon un peu addictive j’accumule des images que je prends et qui sont sans grand intérêt pour beaucoup. À mon âge, ces images deviennent plutôt encombrantes, mais c’est ce qui m’a permis pendant des années, parallèlement à mon travail d’exposition, d’archiver des photographies de mon entourage que je traquais en permanence avec l’appareil photo que je portais toujours sur moi. J’envoyais de façon rituelle à chacun son image toujours dans une enveloppe en kraft, tamponnée à mon nom et timbrée avec soin. J’ai pris conscience longtemps après qu’il s’agissait d’un vrai travail. Je ne retouchais aucune photo, et j’aurais dû garder certains retours pour le moins cocasses. C’est seulement en 2002 que j’ai montré ces photos, intégrées autour d’une structure sphérique en plexiglas, lors de mon exposition au MAC. Certains tentaient de se retrouver sur les photos. Une pièce devenue interactive sans que je ne l’ai pas vraiment décidé en amont. Cette démarche devenait à la fois obsessionnelle et onéreuse. Je l’ai peu à peu laissé tomber après le passage de la photo au numérique mais j’ai gardé cette pratique plusieurs années. Je pense que beaucoup ont rangé et gardé leurs enveloppes mais d’autres ont dû les jeter, ce qui est un peu dommage.

Vous n’avez jamais pensé à en faire une édition ?
Je regrette beaucoup de ne pas l’avoir fait. Cependant certaines de ses images ont été intégrées dans le catalogue de mon exposition au Mac par Francine Zubeil. De son côté, Denis Prisset, dans un autre de mes catalogues, Des Histoires, a ajouté à l’intérieur des feuillets à part où l’on peut en découvrir un certain nombre.
Quelques mots sur la sérigraphie que vous avez faite avec l’atelier Tchikebe ?
C’est encore une photographie issue cette fois d’un album de mon père. Cette image incroyable (anonyme ?) avec cet hélicoptère affublé du mot ART, dont je n’ai pas encore vraiment trouvé l’origine, m’a tout de suite fait penser au plongeon dans le vide d’Yves Klein. Là encore j’ai eu besoin de transformer cette image et d’en faire, cette fois, une sérigraphie.

Quels usages faites-vous de la vidéo ?
J’ai commencé comme avec la photo. J’avais une petite caméra dans mon sac, et après avoir filmé quelques séquences au hasard, j’ai eu envie d’aller plus loin. Ceci dit, la vidéo n’a pas le même temps. L’image fixe est plutôt la réalisation d’une idée, il me semble, alors que la vidéo est plus de l’ordre de sa transformation.
Les images de Pourquoi tu pars ? sont certainement de l’ordre d’images manquantes, quand à Un séjour tout compris, il s’agit toujours pour moi du regard que je porte sur l’histoire coloniale. Dans Pourquoi tu pars ?, j’utilise encore des photos. Cette fois, ce sont celles de mon père, ramenées de son retour d’Indochine dans les années cinquante. Elles sont intégrées au montage sans être pour autant un diaporama. En fait, c’est le son (des armes, d’une machine à écrire, etc) qui donne à la vidéo une sorte de narration sans être vraiment présente, non plus. Le titre est lié pour moi au film Cria Cuervos de Carlos Saura qui date de 1976. Les images d’un passé et d’un présent faisant constamment irruption chez une petite fille à laquelle je pouvais m’identifier.
La chanson Porque te vas ? que l’enfant écoute sans fin, m’a conduite à choisir ce titre pour ma vidéo. J’ajoute que Gwendal Sartre, qui a été mon étudiant et qui depuis quelques années fait ses preuves en tant que réalisateur, est mon monteur de cœur et je le remercie d’avoir été si souvent à mes côtés. Il habite à présent la Bretagne mais je souhaite vraiment avoir le plaisir de retravailler avec lui.
J’ai vu un rapprochement évident entre Un séjour tout compris et la figure du plongeur dans votre œuvre Plongeons.
À part certaines images de plongeurs, il est vrai que c’est encore une fois à partir d’archives familiales que je l’ai réalisé. Des archives pour moi particulièrement impressionnantes. Les images ont été prises lors d’une croisière pour Haïti (surnommée la Perle des Antilles) au début des années 1960 à bord du paquebot France. À leur arrivée, des passagers jettent des pièces de monnaie aux insulaires indigènes qui sont dans l’eau et qui tentent comme ils peuvent de les récupérer. Un couple de collectionneurs que je respecte, a acquis cette dernière vidéo. Je peux dire que ces deux vidéos s’inscrivent toutes les deux dans mes réflexions sur l’histoire coloniale.

La vidéo est-elle pour vous plus narrative que la photo ? Je pense à “Anaphore” qui est très cinématographique.
La narration peut conduire au pire mais il est vrai que je pars souvent d’un souvenir qui me concerne et que je développe mais j’aime bien laisser une part d’interprétation aux autres et ne pas trop être explicite. Quand, pour ma vidéo Only you, j’ai demandé à ma mère de me parler du souvenir le plus fort qu’elle avait de ma sœur aînée, morte jeune, elle m’a parlé du disque Only you des Platters, que nous écoutions elle et moi, adolescentes. Il est évident que rien n’est dit de cette tragédie dans ma vidéo. On voit juste ma mère écouter ce disque les yeux dans le vague avec un léger mouvement des lèvres comme si elle chantait.


En ce qui concerne Anaphore, c’est l’histoire revisitée d’Isadora Duncan. La narration existe donc déjà en amont. Elle est morte, tout comme ma sœur, d’un accident de voiture, mais je ne révèle rien la concernant.
Caroline Hancock dit que vous inventez des histoires et que vous revisitez des mythes. Votre monographie, publiée par les éditions P, s’intitule Des histoires.
Je ne savais pas comment choisir un titre pour ce catalogue. On s’est décidé avec Denis pour Des histoires, ce qui peut donner une réponse à votre question : les photos sont-elles plus narratives que les vidéos ? À leur façon, des images familiales sont loin d’être abstraites mais chacun peut les interpréter à sa façon.


La figure du miroir est très présente dans vos travaux.
Le miroir est très important pour moi. Quand j’étais dans mon atelier, “à bricoler”, il y avait des vieux morceaux de miroirs cassés. Je les disposais pour pouvoir me photographier. C’est ce qui m’a amené à réaliser La conversation, peut-être cinq ou six ans après. J’aimais déjà beaucoup Francesca Woodman et Alix Cléo Roubaud, qui donnaient à voir leur intimité, dans leur appartement ou leur atelier. J’étais très sensible à cette approche. Je les affectionne toujours beaucoup d’ailleurs. Ces images que j’appelle “intermédiaires”, j’en ai un grand nombre que je n’ai jamais montré. Des images de travail en cours aussi, peut-être plus intéressantes que les suivantes. Je ne sais pas. Le miroir est d’une certaine façon l’inverse de la vie. Une frontière entre l’intérieur et l’extérieur. Une façon encore d’être de l’autre côté. Le réel n’est plus qu’un reflet.Toutes les images de mon exposition à la Villa Noailles en 2000, Droit de visite, ont été réalisées à partir d’un grand miroir circulaire posé au sol sur lequel des personnages se mettent en scène. Il m’a permis ainsi de brouiller les repères et d’y faire figurer l’apesanteur. Le réel a dépassé la fiction et s’est ouvert sur un monde imaginaire. J’aime ce monde à l’envers. C’est en effet un espace mental et abstrait
Revisiter vos archives, votre travail ?
Je pense que c’est effectivement nécessaire. Il le faut, mais bien entendu, je remets toujours au lendemain. Devoir quitter mon dernier atelier où j’avais amassé plus de 35 ans de travail m’a, malgré ma déception, permis de commencer un travail d’archivage et de déstockage qui n’en est qu’à son début , si je veux le mener de façon un peu expéditive mais rationnelle. Le stockage de leur travail est un vrai problème pour les artistes. Je pense qu’ils se doivent de le faire pour ne pas laisser cette épreuve à leurs descendants. Je pense qu’il faut en détruire un certain nombre mais ce n’est pas toujours facile. Où vont les œuvres après la mort des artistes ? Si l’on a un peu de notoriété, une solution peut être envisageable pour une partie du travail.
Vous êtes quand même connue !
Pas assez. Heureusement, j’ai pu acheter un local de stockage il y a deux ans, ce qui me calme un peu. Actuellement je dessine, ce qui a au moins l’avantage de ne pas trop m’encombrer.
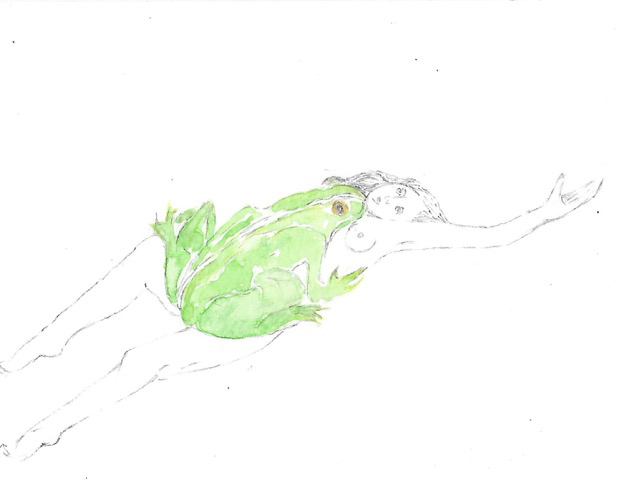

Là aussi, ce sont des images mentales que vous couchez sur papier ?
C’est en tout cas de l’ordre de l’imaginaire. Je retrouve, il est vrai, les mêmes thèmes utilisés dans mon travail photographique qui resurgissent de façon récurrente et visible dans mes dessins. Le dessin offre, avec peu de moyens, une liberté jubilatoire.
Vous considérez-vous féministe ?
C’est impossible pour moi de ne pas l’être. Si je ne l’étais pas, je le deviendrai. Je suis de la génération de l’émergence du mouvement des femmes dont je me sens solidaire mais je ne peux pas dire que je sois féministe au sens militant. Ce qui est terrible aujourd’hui, c’est de voir que des luttes fondamentales, qui semblaient acquises, peuvent être remises en question. Les artistes femmes sont déjà subversives par leur seule présence dans le champ de l’art.
Comment vos parents ont perçu votre travail ?
Mon père n’a pas vraiment vu mon travail, il est mort à 72 ans, mais ma mère, oui. Elle retrouvait toute la famille dans mes autoportraits par exemple. Bien sûr, elle s’est interrogée quand elle a vu C’est une fille mais elle me faisait toujours confiance dans mes choix. Je pense qu’elle comblait à travers mon travail sa frustration de n’avoir pas pu être artiste.
Votre travail a-t-il été l’occasion de parler de certains sujets avec votre mère ?
Oui. Ma mère n’était pas une intellectuelle mais elle s’intéressait toujours à tout ce que je pouvais faire. Elle était assez étonnante, douce et créative. Elle a continué à faire des petits tableaux à plus de 85 ans, ce qui nous donnait une belle occasion de nous parler. Mon père était assez autoritaire mais je dois dire qu’il l’était beaucoup moins à la fin de sa vie.
Allez-vous revenir à la photographie ?
Je ne l’ai pas quittée. Je continue à photographier, chez moi par exemple, deux mêmes fenêtres, de jour et de nuit, lors de mes insomnies. Une série dont je ne ferai certainement rien. On fait semblant d’échapper à la mort, en s’activant sans arrêt, mais l’idée de me consacrer à un nouveau projet me ferait du bien. C’est plutôt une nouvelle vidéo qui me trotte dans la tête. Ce qui est drôle c’est que mon mari après tant d’années de mariage ne m’a jamais prise en photo.
Il va vous dire que vous n’avez pas besoin de lui pour être photographiée !
Oui, bien sûr ! J’imagine qu‘il est en “overdose” d’images avec moi. Je ne sais pas ce que je vais faire de toutes ces boîtes remplies d’images, sans compter mes propres albums de famille que, comme ma mère, j’ai stockés ! C’est peut-être le moment d’en faire un tri serré pour un projet sur… la disparition. Pourquoi pas ?!





![[ ENTRETIEN ]
Abed Abidat Le silence des images un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 lien dans la bio
Éditeur, photographe, animateur-éducateur, Abed Abidat a construit un parcours singulier où création et engagement social se rejoignent, et pour qui l’image, est à la fois un outil de transmission et un moyen d’expression. Du quartier des Aygalades à la création des @imagesplurielleseditions , sa trajectoire mêle travail social, projets artistiques et exploration des mémoires entre la France et l’Algérie. Une œuvre guidée par le désir de raconter des histoires et de laisser des traces.
📷 La rue Les enfants, Le Panier, Marseille (c) Abed Abidat](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
